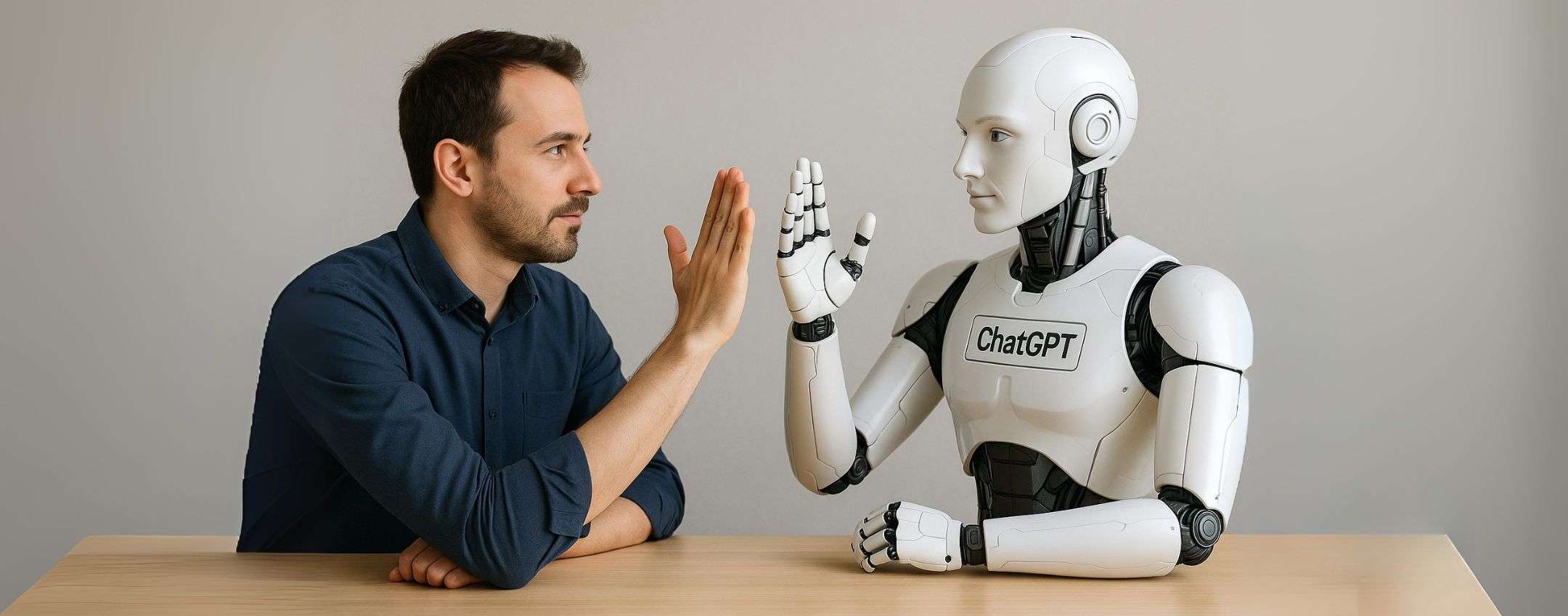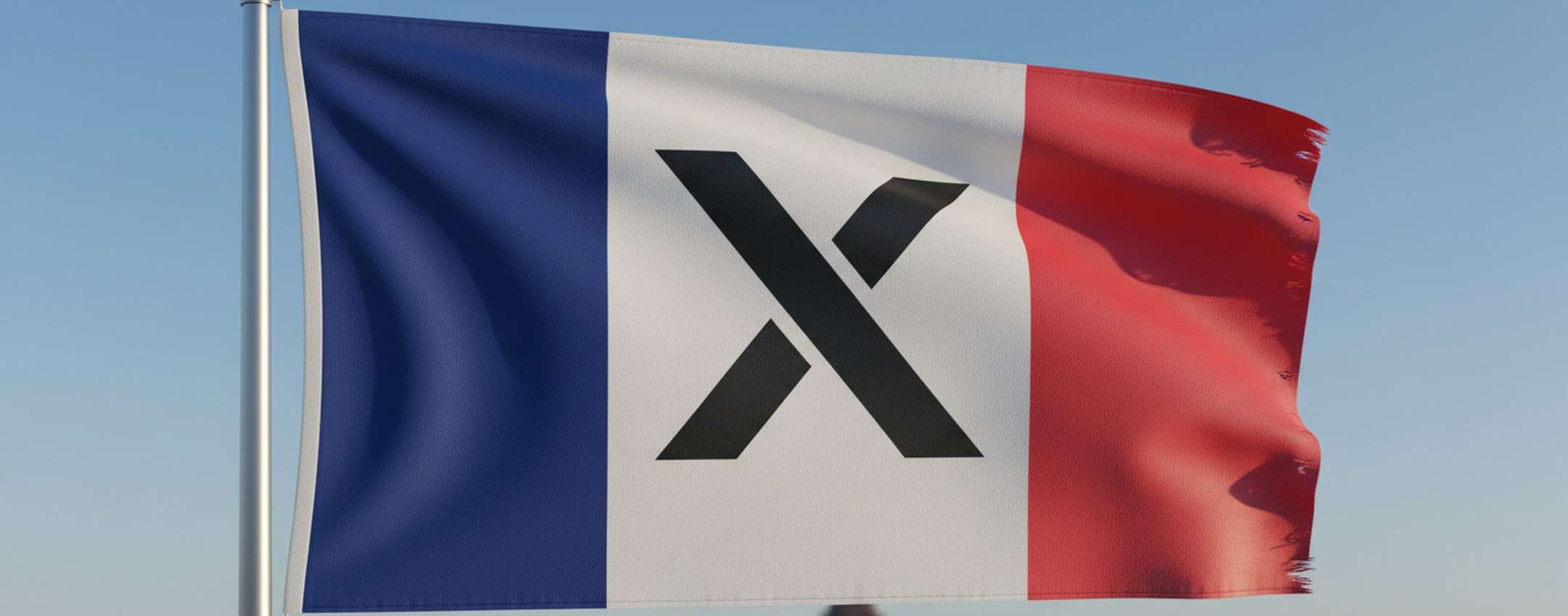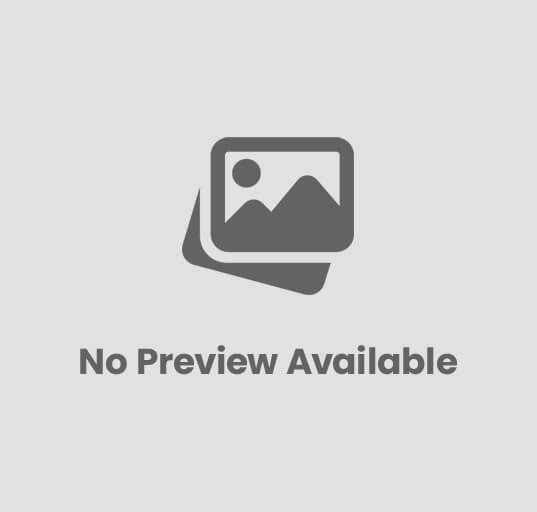ChatGPT change notre façon de parler (et c’est flippant) : ces mots ont explosé de 50 % !
Une étude du Max Planck montre l’influence insoupçonnée de ChatGPT
Après 18 mois d’existence, ChatGPT ne se contente plus de répondre à nos questions : il façonne notre façon de parler. Une recherche menée par le Max Planck Institute dévoile une hausse spectaculaire de 50 % de l’usage de certains mots « préférés » du chatbot dans des vidéos YouTube jugées « sérieuses ». Résultat : un véritable « dialecte artificiel » est en train de se diffuser, et nous n’en avons même pas conscience.
Méthodologie : 280 000 vidéos et 20 000 chaînes analysées
Pour mesurer cet effet, les chercheurs ont choisi trois types de contenus en anglais : présentations académiques, débats institutionnels et discours officiels. Ces formats, a priori peu exposés à la mode numérique, ont pourtant révélé :
L’objectif était d’écarter toute hypothèse d’évolution spontanée du langage. Les résultats montrent une corrélation forte entre l’explosion de l’usage de certains mots et l’adoption massive du chatbot.
Les mots « star » de l’influence : delve, realm, meticulous
Trois exemples illustrent parfaitement la contagion linguistique :
Ces mots, rares en conversation « naturelle » auparavant, s’imposent désormais dans des échanges quotidiens, des réunions ou des conférences, jusque dans des contextes informels où ils paraissent incongrus.
Au-delà du vocabulaire : structure, ton et rythme
L’étude ne s’est pas limitée au lexique. Elle révèle également :
En somme, ChatGPT impose son architecture de phrase et son ton didactique, modifiant non seulement les mots mais la musique même de notre langage.
Risques pour la diversité linguistique et la créativité
Pour les chercheurs, cette homogénéisation comporte des dangers :
Le langage, reflet de la pensée, verrait sa palette de nuances réduite, créant un terrain fertile pour les discours standardisés et les opérations de communication de masse.
Vers un « dialecte artificiel » : enjeux sociétaux et éthiques
Si l’effet ChatGPT s’amplifie, nous pourrions assister à la naissance du premier dialecte non humain de l’histoire, capable de :
Ce « dialecte artificiel » interroge notre capacité à conserver une parole authentique, reflet d’identités et de cultures variées.
Que faire pour préserver l’originalité de notre langage ?
Face à ce constat, plusieurs pistes émergent :
Ainsi, nous pourrons bénéficier des apports des intelligences artificielles sans sacrifier la richesse et la spontanéité de notre langue.