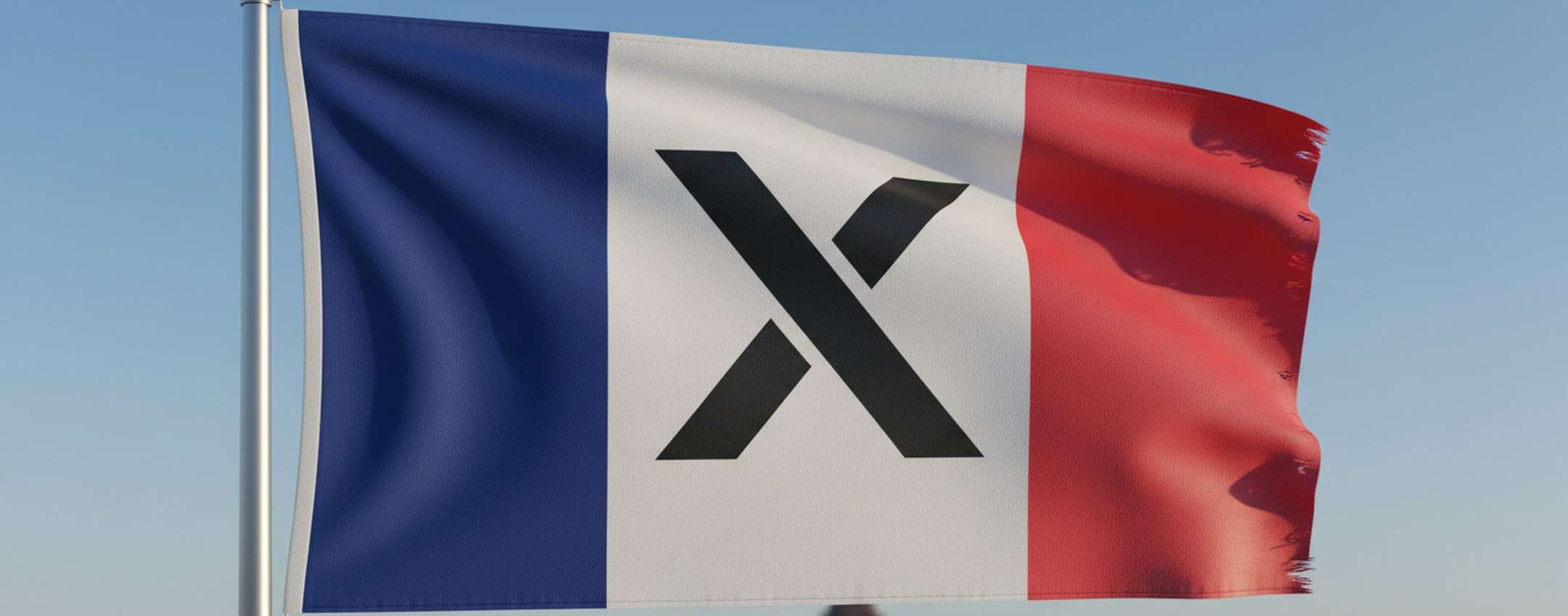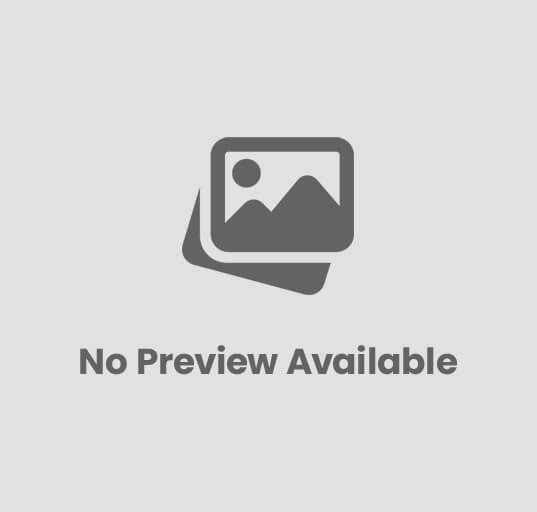https://www.punto-informatico.it/app/uploads/2025/05/Google-Texas.jpg
Un accord historique pour mettre fin aux poursuites texanes
En mai 2025, Google a accepté de verser 1,375 milliard de dollars à l’État du Texas pour solder deux contentieux amorcés en 2022. À l’origine, ces poursuites opposaient le procureur général du Texas à la filiale américaine de la firme californienne pour « violation massive de la vie privée des consommateurs ». Avec ce règlement, Google évite un procès public et se dégage de potentielles sanctions plus lourdes.
Les racines des poursuites de 2022
Au printemps 2022, les autorités texanes avaient lancé deux actions en justice distinctes, mais convergentes, visant à démontrer que Google collectait et utilisait des données personnelles sensibles sans respecter les consentements ou les préférences des utilisateurs :
- Le premier recours reprochait à Google de tracker la position géographique des utilisateurs, même après désactivation de la fonction de localisation sur leurs smartphones ;
- Le second acte d’accusation visait les pratiques de monétisation, dénonçant l’exploitation de ces données pour cibler la publicité sans information claire ni autorisation explicite.
Les plaignants, emmenés par le procureur général du Texas, avaient mis en avant une « atmosphère d’impunité » au sein du géant américain, estimant que les règles de protection de la vie privée étaient contournées grâce à la puissance de ses services et de ses algorithmes.
Montant du règlement et répartition
Le montant total de 1,375 milliard de dollars correspond à la somme convenue pour clore l’intégralité des contentieux texans. Cet accord comprend :
- Les frais juridiques et pénalités imposées par l’État du Texas, à hauteur de 900 millions de dollars ;
- Une provision complémentaire de 475 millions pour compenser les utilisateurs texans qui estiment avoir été lésés ;
Google s’engage également à revoir certaines de ses pratiques de collecte de données, sous la surveillance d’un expert indépendant désigné par la justice texane.
Engagements concrets de Google
Au-delà du paiement, l’accord inclut plusieurs promesses de la part de Google :
- Mise en place d’une transparence accrue sur les paramètres de confidentialité, avec des notifications plus explicites concernant la collecte de position ;
- Réduction des durées de conservation des données de localisation et des journaux de navigation, afin de limiter le risque d’usage détourné ;
- Nomination d’un « privacy officer » en charge de coordonner les actions correctrices et de communiquer auprès des autorités texanes chaque trimestre.
Ces mesures doivent entrer en vigueur sous trois mois et seront soumises à un audit indépendant pendant deux ans.
Conséquences pour les utilisateurs et le secteur de la tech
Le règlement texan constitue une victoire pour la protection des données personnelles et marque un tournant dans la politique de régulation des géants de la Silicon Valley. Pour les consommateurs, cela signifie :
- Une meilleure maîtrise de leurs informations de géolocalisation ;
- Un accès simplifié aux réglages de confidentialité ;
- La possibilité de bénéficier d’une indemnisation si leurs droits ont été subrepticement bafoués.
Dans le même temps, cette affaire envoie un message fort aux autres grands acteurs du numérique : les autorités étatiques sont prêtes à agir vite et fort pour faire respecter la vie privée des citoyens, même si cela implique des règlements financiers substantiels.
Le précédent texan et l’émulation d’autres États
Le Texas n’est pas le seul État américain à avoir poursuivi Google sur le terrain de la vie privée. D’autres États, comme l’Indiana ou la Floride, avaient déjà actionné la justice en 2022 sur des motifs similaires. Le règlement texan, par son montant record, crée un précédent obligeant les responsables politiques de plusieurs juridictions à davantage se coordonner pour imposer des normes homogènes aux géants de la tech.
Enjeux futurs : la vigilance réglementaire
Alors que l’Union européenne prépare de nouvelles lois pour renforcer le règlement général sur la protection des données (RGPD) – avec des sanctions pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial –, l’affaire texane démontre que la pression réglementaire s’intensifie aux quatre coins du monde. Les entreprises de la « Big Tech » devront désormais intégrer la défense de la vie privée au cœur de leurs stratégies commerciales, sous peine de voir leur image sérieusement entachée et leur trésorerie mise à mal.
Ce que cela change pour Google
En acceptant ce règlement, Google souhaite tourner la page rapidement et concentrer ses efforts sur l’innovation plutôt que sur les batailles juridiques. Cependant, la firme doit désormais démontrer concrètement sa bonne foi et veiller à ce que les promesses prises ne restent pas lettre morte. Sous observation accrue des autorités et des associations de défense des consommateurs, chaque nouvelle faille dans ses pratiques de collecte pourrait entraîner des poursuites renouvelées.
L’ampleur du défi pour la protection des données
À l’heure où les objets connectés et les services mobiles se multiplient, la question de la confidentialité des données personnelles s’impose comme un enjeu majeur de société. Entre efficacité des services numériques et respect du droit à la vie privée, le compromis reste délicat. Cet accord entre Google et l’État du Texas offre un premier jalon, mais la vigilance des pouvoirs publics et des usagers devra demeurer constante pour préserver les libertés individuelles face à l’expansion technologique.