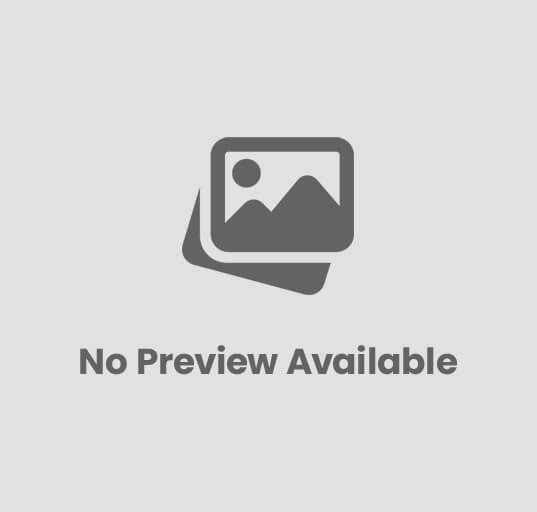Vous paierez bientôt 25 % de plus sur votre iPhone : Trump menace TOUS les smartphones importés !
Donald Trump a relancé une polémique de taille en menaçant d’instaurer, d’ici fin juin, un droit de douane de 25 % sur tous les smartphones importés aux États-Unis. Cette mesure viserait en priorité les géants qui produisent hors sol américain, à commencer par Apple, mais aussi Samsung, Google et autres fabricants asiatiques. Un ultimatum qui rouvre le débat sur la relocalisation de la production high-tech et ses répercussions économiques et géopolitiques.
Un message clair pour Apple et ses concurrents
Lors d’une rencontre à la Maison-Blanche avec Tim Cook, président d’Apple, Donald Trump a confirmé son intention de taxer à 25 % les iPhone assemblés en Inde ou en Chine si la firme ne rapatrie pas ses lignes de production sur le sol américain. Le Président a étendu cette menace à l’ensemble des fabricants de téléphones portables importés, soulignant qu’il souhaite protéger les emplois et les intérêts industriels des États-Unis.
Les raisons avancées par l’administration américaine
Selon le locataire actuel du Bureau ovale, ces droits de douane supérieurs viseraient :
- À réduire le déficit commercial avec la Chine, grande pourvoyeuse de composants et d’assemblages électroniques.
- À inciter les entreprises à investir dans des usines « Made in USA » pour renforcer la souveraineté technologique.
- À préserver et créer des milliers d’emplois dans la chaîne de production, de la fabrication de puces à l’assemblage final.
Impossibilité technique et coûts prohibitifs
Les spécialistes de la filière soulignent la complexité de ce pari. Le smartphone moderne regroupe des milliers de pièces, issues d’un écosystème de sous‐traitants spécialisés implantés principalement en Asie :
- Usines de semi‐conducteurs en Corée du Sud, Taïwan et Chine continentale.
- Sites d’assemblage en infrastructures à la pointe mais concentrées hors des frontières américaines.
- Main‐d’œuvre qualifiée, souvent formée depuis plusieurs décennies sur place.
Recréer un pôle équivalent aux États‐Unis nécessiterait des investissements massifs et du temps. De plus, la main‐d’œuvre y est plus onéreuse : l’étude interne d’Apple évoque un coût de production multiplié par deux, voire trois. Un iPhone 16 Pro Max doté de 1 To de stockage pourrait alors coûter près de 3 500 $, contre environ 1 600 $ aujourd’hui. Le prix risquerait de dissuader les consommateurs et de réduire drastiquement le volume des ventes.
Profits sacrifiés ou facture client ?
Donald Trump a précisé que les entreprises ne pouvaient pas répercuter ce surcoût sur les consommateurs. Or, absorber un droit de douane de 25 % grèverait lourdement les marges déjà serrées des fabricants. Face à cet arbitrage, deux options se présentent :
- Réduire les bénéfices, un choix impopulaire auprès des actionnaires et des fonds d’investissement.
- Augmenter les prix, malgré l’engagement présidentiel, entraînant un risque de désaffection des acheteurs.
Dans un contexte où la concurrence s’intensifie, notamment entre Apple, Samsung et les Chinois de Huawei ou Xiaomi, la question reste ouverte : qui supportera la note ?
La riposte juridique de la Californie
Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a d’ores et déjà annoncé qu’il envisageait d’attaquer l’administration Trump devant les tribunaux. La Silicon Valley représente à elle seule une part significative du PIB de l’État : Apple, Google, Facebook et les start‐ups génèrent des milliers d’emplois et d’impôts locaux. Selon lui :
- Imposer des tarifs ad valorem sur les smartphones constitue une atteinte aux libertés économiques garanties par la Constitution californienne.
- Les consommateurs et les petites entreprises californiennes subiraient directement la hausse des prix.
- Les retombées fiscales sur l’État, fondées sur les ventes et l’impôt sur les sociétés, seraient en forte baisse.
Un bras de fer judiciaire et politique se profile donc entre Washington et Sacramento, avec pour enjeux l’emploi et la santé économique de la Californie.
Conséquences sur la chaîne d’approvisionnement mondiale
Au-delà des frontières américaines, cette annonce pourrait bousculer l’équilibre des échanges mondiaux :
- Des droits de douane à 25 % risqueraient de pousser la Chine à riposter, portant atteinte aux secteurs agroalimentaire et automobile.
- Les pays exportateurs de composants électroniques (Taïwan, Corée du Sud) verraient leurs débouchés américains menacés.
- Les investisseurs internationaux pourraient revoir leur stratégie, craignant un protectionnisme à géométrie variable.
En résumé, les chaînes just‐in‐time, calées depuis vingt ans sur des flux transpacifiques continus, seraient contraintes de se réinventer, avec des coûts logistiques en forte progression.
Un ultimatum à l’aube de l’ère post‐iPhone ?
Dans un entretien récent, un porte‐parole d’Apple a rappelé l’attachement de la marque à ses usines texanes, qui assembleront à l’été 2025 un modèle d’iPhone 16 destiné à des tests en conditions réelles. Toutefois, passer de quelques milliers à plusieurs millions d’unités est jugé irréaliste à court terme.
Si poliment invitée, l’industrie high‐tech américaine se trouve à la croisée des chemins : relever le défi de la relocalisation ou s’exposer à des droits de douane massifs. Le compte‐à‐rebours jusqu’à fin juin est lancé ; l’issue de cette négociation pourrait redessiner la carte de la mobilité numérique à l’échelle planétaire.